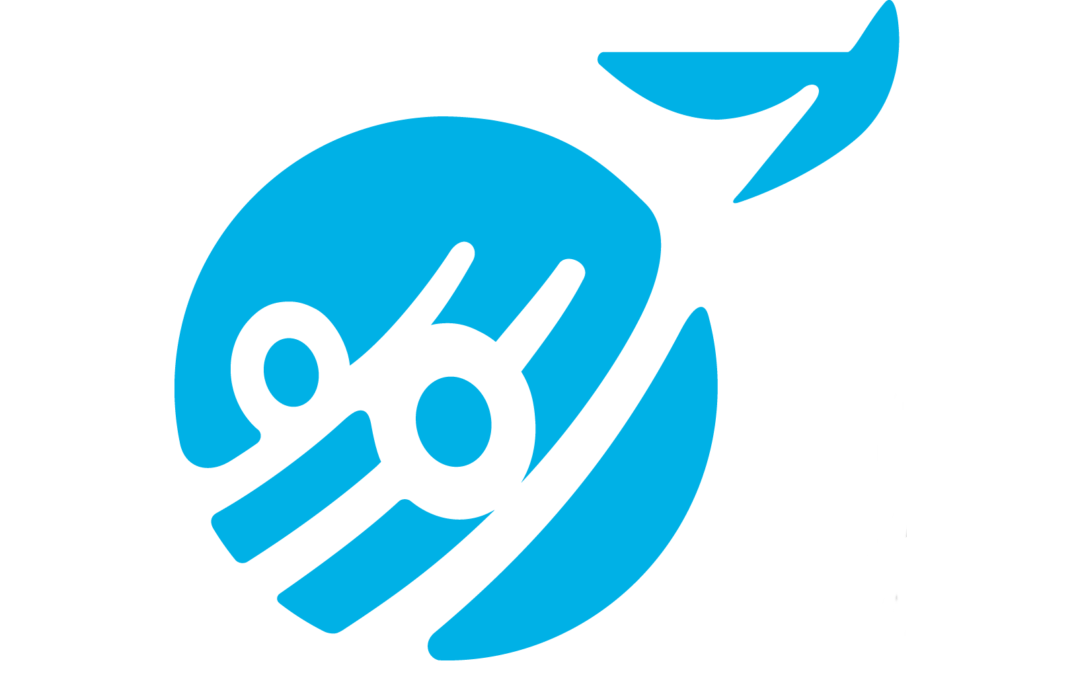samedi 10 juillet 2021 | Conférence
Le 7 juillet 2021, Le Dorothy a été bondé pour la venue, pour la première fois en ce lieu, de Bernard FRIOT, économiste reconnu, théoricien de la notion de “salaire à vie”, animé à la fois par une pensée originale du communisme et par une intense foi catholique.
Dans le cadre d’un partenariat avec la librairie voisine Le Monte-en-l’air, des livres de Bernard Friot ont été mis en vente dans la foulée de la conférence.
Quatre questions principales ont structuré l’intervention de notre hôte :
- qu’entend-il par la notion de “salaire à vie” ?
- quelle est sa conception du communisme ? Quels sont les moyens d’y parvenir ?
- comment articule-t-il sa foi catholique et son projet de société communiste ?
- quel regard porte-t-il sur les élections présidentielles à venir ?
Bonne écoute à toutes et tous !
Lien audio : https://anchor.fm/le-dorothy/episodes/Bernard-Friot-au-Dorothy–salaire–vie–communisme—christianisme-e148co6
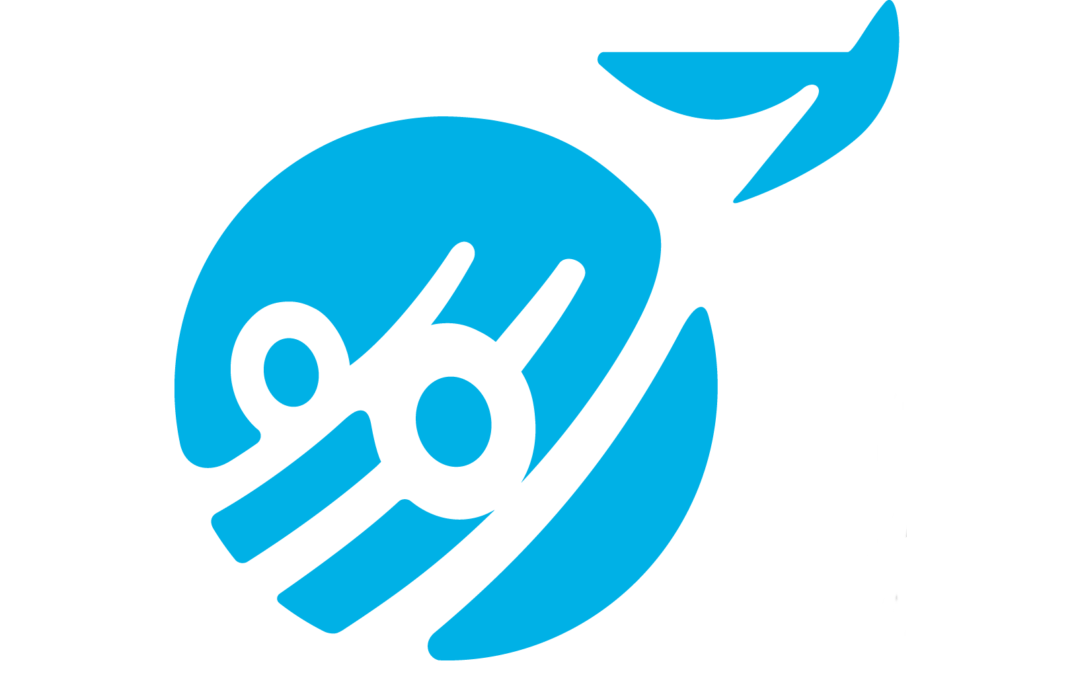
jeudi 10 juin 2021 | Conférence
Le 10 juin 2021 a eu lieu la dernière conférence du cycle Grand pauvreté co-organisé par ATD Quart Monde et Le Dorothy.
Apprendre de ceux qui résistent à la misère : le paradoxe Wresinski (fondateur d’ATD Quart Monde).
En ce début du XXIe siècle, nous faisons face à des défis majeurs. La misère est l’un de ces défis qui perdure et continue de détruire la vie de millions de personnes. Or l’humanité se prive de la rencontre avec ceux qui y résistent. Joseph Wresinski (1917-1988), combattant contre cette misère et fondateur du mouvement international ATD Quart Monde, nous confronte à un paradoxe : de ceux qui résistent à la misère, nous avons, avant tout, à apprendre. “Les pauvres sont nos maîtres !” disait saint Vincent de Paul dans une formule restée célèbre. Mais peut-on apprendre quelque chose, peut-on attendre quelque chose des plus pauvres ? C’est là l’objet du livre Les pauvres sont nos maîtres dont les auteurs sont les intervenants de la conférence.
Intervenants : Bruno Tardieu, volontaire permanent d’ATD Quart Monde depuis 1981, est directeur du Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski.
David Jousset, philosophe, est maître de conférences à l’Université Bretagne-Occidentale (à Brest), chercheur en philosophie sociale. Ensemble ils dirigent le séminaire « Penser ensemble l’être social avec Joseph Wresinski ».
Nous n’avons pas le résumé de cette conférence mais en guise de réflexion sur ce thème très riche, nous vous encourageons à lire ce magnifique article de Daniel FAYARD, volontaire ATD Quart Monde, qui réfléchit à partir de la célèbre formule de saint Vincent de Paul citée en titre de cet article : https://www.revue-quartmonde.org/924
mercredi 24 mars 2021 | Article
Par Foucauld.
Tu ne m’appartiens pas.
En arrière de ma vie, l’obscurité,
Et sous mes pas, l’impermanence.
Je ne m’appartiens pas.
En avant de ma vie, l’incertitude,
Et au-dessus de moi, les étoiles mouvantes.
Seulement le tenace désir
D’écouter Ta promesse
Me recréer.
***
Comme une mouche obstinée
Butant sur l’incompréhensible obstacle de la vitre
Qui la sépare de l’odorant jardin fleuri,
Nous butons les uns contre les autres,
Nous fracassons contre le mal,
Nous fissurons contre la peur.
Il n’y a plus que la pensée entortillée
Dans ce qui la nie, l’humilie et l’afflige.
L’obstacle seul se fait réel, devient un mur.
Par quel élan lucide, par quel emportement pur, parviendrons-nous
À gagner la hauteur où se font sensibles Tes dons,
Ceux-là qui ne cessent de s’offrir comme vie véritable ?
***
Le ciel pâle me dévisage
sans me voir,
la lumière glisse en moi
sans me toucher :
toute l’innocente beauté du monde m’enveloppe
sans m’inclure en ses jeux.
Je me sens la parcelle d’une profuse indifférence.
De quelle nature serais-je l’enfant perdu,
par quel mystère mon cœur en serait-il exclu ?
Ma pensée se cogne à ma vie
comme un insecte sur le miroir.
Ma conscience ébréchée libère
un appel éperdu.

mardi 9 mars 2021 | Article, Témoignage
Par Anne Waeles — février 2021
Je suis partie quelques jours à Calais, pour me rendre compte d’une réalité dont je n’ai que de vagues informations, et pour être inspirée par les personnes qui oeuvrent là-bas, présentes dans ces marges du monde, qui répondent à l’exigence de l’évènement.
Évènement : fait auquel aboutit une situation, tout ce qui se produit, tout fait qui s’insère dans la durée. La situation à Calais n’est pas un simple fait, et elle n’est pas non plus fatale, je m’en rends compte là-bas. Elle pourrait être réglée s’il y avait une volonté politique de le faire. Mais surtout, plus qu’elle ne se produit, elle est produite, par les guerres évidemment, puis par l’État français, par la Grande-Bretagne, par l’Union Européenne, par la mairie.
À la gare, je suis accueillie par Philippe et Abdullah. Philippe est jésuite, il vit dans une maison avec des exilés. Abdullah est un de ses colocataires, il vient d’Afghanistan. C’est chez eux que je suis accueillie quelques jours. Ils sont plusieurs par chambre. Philippe dort sous la tente, sur le terrain devant la maison, avec Michel.
Parce qu’en face il y a la « crèche », c’est une maison diocésaine que le Secours Catholique a aménagé en lieu d’hébergement. La mairie cherche à décourager cette initiative, pour l’instant par la visite d’une commission de sécurité.
Pour que le lieu soit aux normes, il faudrait un système d’alarme incendie centralisé. Des travaux couteux et longs. Peut-on vraiment penser qu’il faille mieux dormir dehors, sous la tente, et être réveillé chaque matin par la police, que d’être au chaud, dans un lit, dans une maison qui sinon serait inoccupée, et où il n’y a pas d’alarme incendie centralisée ? C’est cela qu’on appelle la politique ?
Alors Philippe dort sous la tente, pour manifester quelque chose de la réalité : on ne veut pas que les exilés soient visibles, on ne veut pas non plus qu’ils dorment à l’abri, mais ils pourraient tout aussi bien dormir sous la tente, à côté de la maison. La directrice de l’école voisine s’est inquiétée en voyant des tentes apparaître. Puis rassurée, finalement c’était « le prêtre » qui y dormait.
Le lendemain, Philippe est parti pour la journée, je me sers dans les placards pour le petit-déjeuner, comme il me l’a indiqué. Dans la maison, une icône de la sainte famille en exil d’Arcabas côtoie une citation de l’essai Carte Blanche, L’État contre les étrangers, et une déclaration des Droits des personnes sans-abri. Je suis accueillie tour à tour par les gars qui vivent là et qui n’ont pas l’air surpris qu’il y ait du passage dans la maison. L’un part au lycée pour sa formation d’électricien, l’autre nettoie la salle de bain, un autre me demande si je veux manger des œufs pour le petit-déjeuner, Abdullah m’accompagne au Secours Catholique où je vais passer la journée. Le soir on mangera ensemble, et Philippe évoquera les miettes sur la table et les choses communes qui ne sont pas toujours considérées comme telles, mais où chacun vient simplement puiser ce dont il a besoin. Cette vie commune qu’ils aménagent, je me dis que c’est déjà un début de politique.
« La rétention en France et en Europe est d’abord une machine à broyer les étrangers. Les personnes réveillées dans leur tente par des hurlements et ces duvets lacérés, ces personnes interpellées aux guichets de préfecture, contrôlées dans la rue, humiliées, menottées, matraquées, assignées dans des chambres d’hôtel, ces personnes qu’on enferme avec leurs enfants, ces jeunes qui vivent dans la rue dont on radiographie les dents ou les poignets, tout cela n’a pas seulement pour objectif d’expulser d’Europe 6000 personnes par an. Tout cela est puissance de mort. »
Carte Blanche, L’État contre les étrangers, Karine Parrot
Le matin, au Secours Catholique, j’assiste à une réunion où tous les salariés et bénévoles font le point sur leurs actions. On commence par écouter Calais Border Broadcast, le nouveau projet de radio lancé par le Secours Catholique, qui vise à diffuser toutes les informations sur les services proposés par les associations à Calais, le droit d’asile en France et en Angleterre, diffuser des nouvelles, et donner la parole aux exilés sur différents sujets dans des ateliers radios. La radio diffuse en français, en anglais, en arabe, en persan, en pastho et en tigrina. Puis la réunion s’anime au gré des différents sujets du moment. On fait remonter les discriminations dont on a pu être témoins : certains supermarchés refusent l’entrée aux migrants, certains chauffeurs de bus ne s’arrêtant pas aux arrêts où il n’y a que des personnes racisées, les contrôles au faciès sont habituels à la gare. On discute des inquiétudes actuelles, notamment de la commission de sécurité envoyée par la mairie à l’accueil de jour comme à la crèche.
À Calais la politique n’est pas une option. À tous les échelons, l’administration met le travail des associations en échec : menace de fermeture de l’accueil de jour du Secours Catholique – le seul de Calais, arrêtés anti-distribution gratuite de nourriture et de boisson dans la ville, démantèlement quotidien des camps et confiscation des affaires des exilés et de leurs tentes. Je prends conscience de l’ampleur de l’action de l’État contre les étrangers, qui vise à les rendre invisibles et à les nier dans leur humanité.
Je découvre en même temps la persévérance ardente de nombreux bénévoles, qui se mettent au service de leurs frères et soeurs, et ne se laissent pas décourager par l’ampleur de la tâche et le cynisme de leurs adversaires politiques. Dans l’équipe de bénévoles du secours catholique, beaucoup sont retraités, beaucoup viennent de milieux populaires, il y a aussi d’anciens exilés. Je découvre aussi leur créativité au service du bien commun. On évoque la possibilité de tenir des banquets avec des chefs cuisiniers dans Calais pour contester les arrêtés anti-distribution. On annonce la venue de l’évêque d’Arras Mgr Olivier Leborgne et de la présidente du Secours Catholique, Véronique Fayet, pour interpeller l’État et demander l’ouverture de lieux d’hébergement et d’accueil et la fin des politiques d’expulsions. On parle de l’étude à venir pilotée par la plateforme des soutiens aux migrants, qui fédère toutes les associations d’aide aux migrants du littoral franco-britannique : réaliser une nouvelle étude pour actualiser celle de 2016, et comprendre les difficultés des exilés, ce qui les a amenés là et ce dont ils ont besoin. Une deuxième étude fera un bilan des politiques publiques avant les législatives et présidentielles de 2022 pour influer sur la campagne et formuler des propositions.
L’après-midi, près de 400 personnes viennent à l’accueil de jour, pour prendre un café, jouer au foot ou au ping-pong, recharger son téléphone, faire sa lessive dans les lavabos, se faire tirer le portrait par une dessinatrice, discuter. Quelques heures volées à un quotidien de soucis et de survie. Arthur qui cherche à créer une école pour les exilés à Calais vient donner un cours d’anglais. Dans un coin de l’immense salle, une dizaine de gars sont massés autour de lui, les visages attentifs et réjouis.
Je suis frappée par le public : majoritairement jeune, exclusivement masculin. Il y a quelque chose d’infiniment pesant dans la combinaison de leur force vitale et de leur désœuvrement. À 16h je suis sonnée par ce tourbillon, et je m’éclipse pour aller voir la mer.
Le samedi Arthur me fait visiter l’auberge des migrants. Un immense hangar où plusieurs associations travaillent conjointement pour préparer des repas à distribuer – une cuisine de collectivité y est installée –, distribuer des vêtements et des tentes, fournir aux exilés de quoi se chauffer. On discute quelques instants avec des jeunes qui se relaient pour fendre des bûches venues d’Allemagne pour en faire des sacs de 7 kg à livrer dans les camps, beaucoup d’entre eux sont anglais, comme de nombreux bénévoles à Calais. Au-dessus de l’atelier bois, un petit écriteau donne du coeur à l’ouvrage : Welcome to the good side of history.
Le soir je visite la maison Maria Skobtsova, fondée par des Catholic Workers à Calais. Je suis accueillie par deux jeunes bénévoles, Marie et Brandon, qui vivent là avec trois familles. La maison a vocation à accueillir les personnes parmi les plus vulnérables, qui leur sont envoyées par d’autres associations : des familles, des femmes seules, des personnes malades ou handicapées. Chacun fait la cuisine à tour de rôle, le menu est iranien ce soir là. Après une bénédiction du repas, les discussions s’animent en plusieurs langues, on se sent vraiment dans un foyer. À l’étage, une femme enceinte se repose. D’un instant à l’autre elle peut avoir besoin d’être conduite à la maternité. Après le diner nous partageons un temps de prière avec Brendon et Marie, dans une partie du salon qui fait office de coin prière. Quand le rideau est tiré, c’est le signal qu’il faut se faire discret. Chacun peut se joindre à la prière qui a lieu chaque soir et matin, et souvent les uns et les autres prient côte à côte, selon leur langue et leur foi. Dans la maison devenue silencieuse, sous les icônes de Jésus et son ami, et de Marie Skobtsova (une sainte orthodoxe audacieuse qui suscite ma curiosité), nous prions pour que toute la maison puisse accueillir la vie du bébé à naître, déjà appelé Timothée. C’est le début du Carême, et nous ouvrons la Bible pour tomber sur le livre d’Isaïe : N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug; renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?
Je repars de Calais bousculée. Je n’ai pas vu de camps, mais le tunnel au loin, et le port. Je n’ai pas vu les camps : on veut les rendre invisibles, mais ils sont présents partout à Calais, dans les discussions, dans les traits fatigués des exilés que l’on croise avec leurs affaires dans la ville, dans la pesanteur de cet après-midi à l’accueil de jour.
Je me demande de quoi Calais est vraiment la frontière. Je me dis aussi que pour moi, femme blanche et de classe moyenne, il n’y a pas de frontière. Les frontières sont pour les étrangers, mais surtout pour les pauvres. Plus une personne étrangère est riche, moins elle est étrangère. Je me demande si j’ai envie d’habiter le monde duquel Calais est la frontière. Ce monde où de l’autre côté se tiennent ces personnes qu’on appelle migrants – illégaux ou légaux – parce qu’on les a exclus.
Quelques jours après être rentrée à Paris, je reçois un courrier de Philippe, qui m’annonce qu’ils ont reçu un arrêté de fermeture administrative pour la crèche – le centre d’hébergement ouvert par le Secours Catholique, et ces quelques mots « C’est la lutte finale ». Je pense aussi à la lettre de Paul aux Corinthiens : « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. »

samedi 20 février 2021 | Article
Par Foucauld. Février 2021.
Toute guérison, parce qu’elle sauve du péril de la mort, met en jeu la question du sens de la vie. N’est-ce pas cette question – et les réponses qu’elle pourrait susciter – qui échappe à notre société frappée par la pandémie ?
Quand nous guérissons, c’est le plus souvent grâce à l’intervention bienfaitrice d’un médecin et à l’assistance prodiguée par l’entourage. La vie guérie, le corps remis d’aplomb, est une vie soignée, c’est-à-dire dont on a pris soin. La vie amoindrie qui reprend possession d’elle-même rencontre inévitablement cette question : à quoi vais-je consacrer mes forces retrouvées ? Toute personne ayant été malade connaît cette exaltante impression de renaissance accompagnant la guérison. A la conscience redécouverte de la mortalité – expérience de pensée offerte à tout malade – succède le sentiment de la vitalité retrouvée. En les sauvant, on donne donc aux vies l’occasion de penser la question de la dépense de leur énergie vitale. Guérie par d’autres qu’elle, toute vie rétablie se demande pour quoi elle veut vivre, à quoi elle désire se consacrer.
Plus la crise actuelle du Covid dure, plus risquent d’apparaître des exaspérations et des clivages mortifères : jeunes contre vieux, personnes impatientes de reprendre le cours de leur existence contre personnes à la santé vulnérable et partisans d’une prudence sanitaire maximum… Éprouvante pour tous, la situation vécue depuis bientôt un an a des conséquences extrêmement diverses : dramatiques et catastrophiques pour certains, gênantes et angoissantes pour d’autres. Ni les discours faisant de la santé le bien suprême sans être capable de le justifier, ni la criminalisation du non-respect des règles sanitaires, ni les moyens importants mis en œuvre pour sauver des vies ne suffisent à donner sens à nos choix éthiques et politiques. S’en contenter nous expose forcément à l’utilitarisme, qui commande de ne pas sacrifier le bien du plus grand nombre à celui du plus petit.
Dès lors, il importe de voir au-delà de la vie menacée, mise en péril par la maladie, pour penser la vie sauvée de la maladie ou simplement épargnée par celle-ci. Les discours de prévention et les dispositifs de protection sont sans doute nécessaires mais insuffisants. Dans notre société, soigner le corps malade, tout faire pour qu’il guérisse, est un impératif pratique et moral. Cela est heureux. Il serait donc insensé de vouloir conditionner le soin au projet de vie souhaité par le malade. Rien n’empêche cependant de puiser aux sources de notre culture afin de penser le sens de cette vie dont nous nous efforçons de maximiser la durée. Les Évangiles sont riches de scènes où le Christ côtoie et échange avec des malades. Dans l’Évangile selon Marc, au chapitre 1, il guérit la belle-mère de Simon, l’un de ses disciples. Voici ce que nous dit le texte : « Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. » Au-delà de la guérison apparemment miraculeuse accomplie par le Christ, l’attitude de l’ancienne malade interpelle : en faisant du service et de la charité la finalité de sa santé retrouvée, elle témoigne que cela constitue à ses yeux la valeur suprême de l’existence. La portée d’un tel texte est universelle. Ni les malades, ni les femmes sont évidemment les seuls concernés ici. Le Christ nous révèle que la vie s’accomplit dans le don de soi, donc que la vie est en droit subordonnée à l’amour. Nous ne sommes pas face à une leçon de morale ; la vocation la plus profonde de l’homme est mise en lumière. Plus que vers la mort, la maladie et la guérison font donc signe vers la question de la valeur suprême de la vie. En ce point, nous sommes tous indistinctement convoqués, étant tous potentiellement malades et fatalement mortels.
Cet article a initialement été publié sur le site du magazine d’actualité La Vie : https://www.lavie.fr/idees/covid-19-la-guerison-met-en-jeu-la-question-du-sens-de-la-vie-71270.php