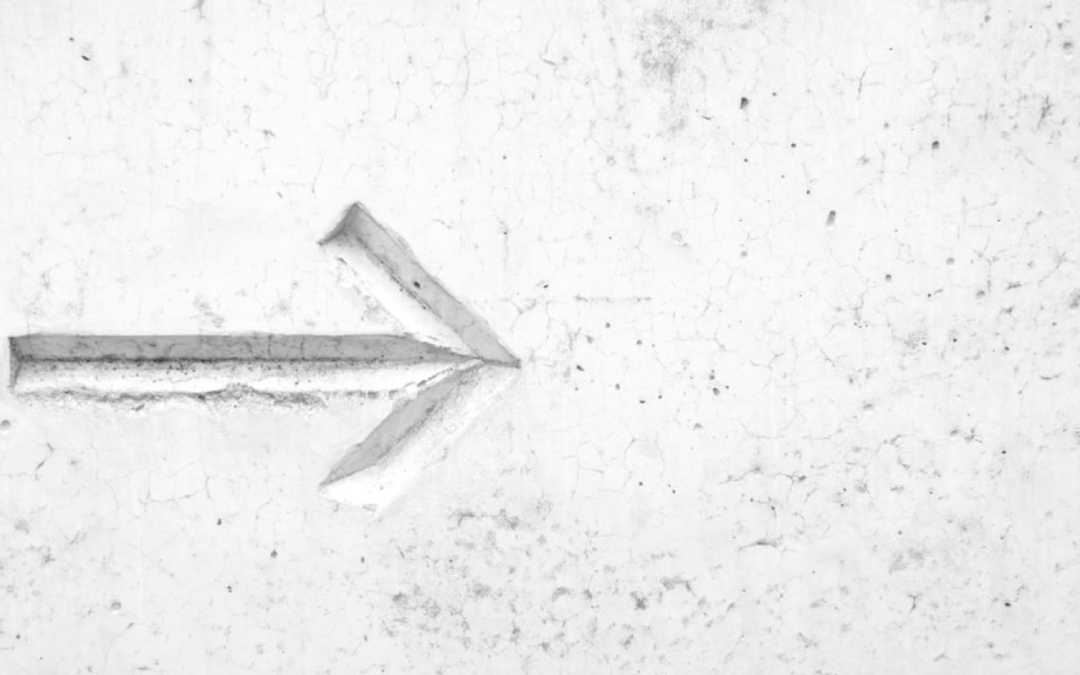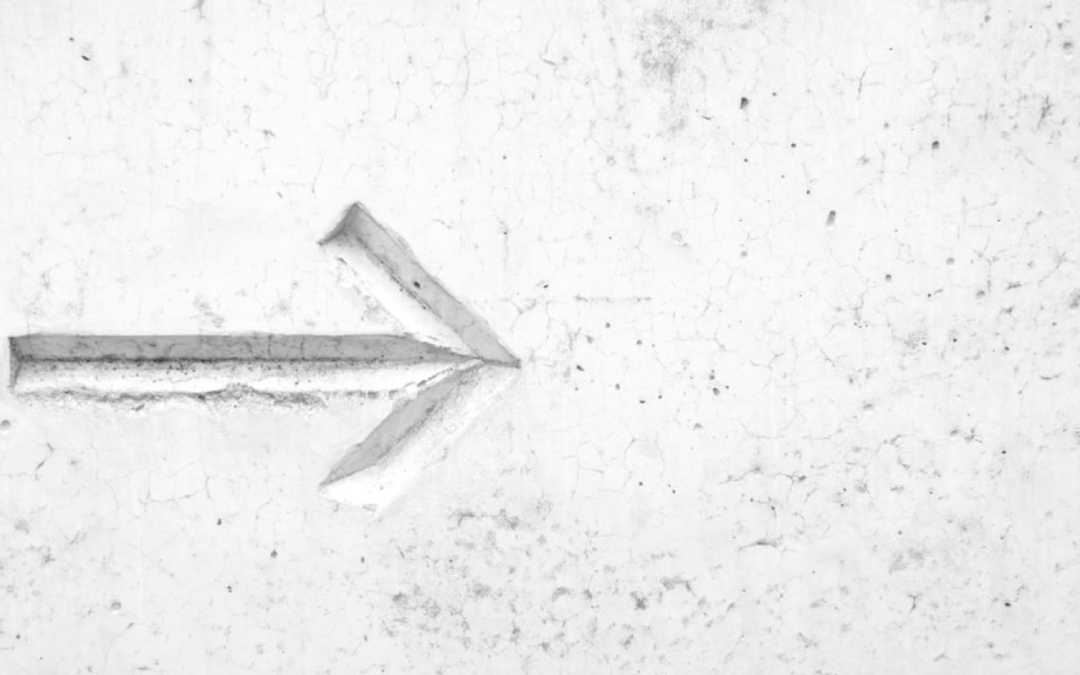
jeudi 21 novembre 2019 | Conférence
Cycle Féminismes et Libéralisme (1/3)
Le 21 novembre 2019, le Dorothy a donné la parole à deux groupements d’associations engagés dans la lutte contre la gestation pour autrui (GPA), la Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS) et CQFD Lesbiennes Féministes. Cette dernière gère également un fonds de solidarité destiné à la prise en charge des frais de justice engagés dans des procédures judiciaires relatives à des cas de violences homophobes.
La GPA n’est pas d’enjeu national
Si elle doit être discutée et combattue en France, la GPA est une problématique transfrontalière. Les parents d’intention non satisfaits sur le territoire national sont susceptibles de se déplacer bien au-delà des frontières, notamment en Inde, aux Etats Unis, en Ukraine. Pour le comprendre, il faut faire un détour par l’ailleurs et comprendre que
chaque pays s’inscrit dans une de ces trois configurations possibles, l’interdiction de la GPA, son autorisation sans condition, son autorisation réglementée.
En Europe, la plupart des pays l’ont interdit depuis les années 1990, seuls quelques-uns l’ont dépénalisée et réglementée, notamment le Royaume-Uni, la Grèce ou la Belgique. A l’opposé les pays de l’ancienne URSS ont tous basculé dans un régime d’autorisation large de la gestation pour autrui à des fins commerciales. Aux Etats Unis, si la pratique est légalisée, le régime d’autorisation diffère selon les Etats et seule une minorité impose un régime strict et réglementé (Etat de NYC).
Le continent asiatique et plus particulièrement l’Inde est historiquement le berceau de la pratique de la GPA commerciale. Des scandales ont récemment entraîné un phénomène de restriction et de limitation de la pratique à un cercle familial. Le « marché » s’est alors tourné vers la Thaïlande (avant de fermer ses portes aux étrangers), le Népal, le Cambodge. Au Népal, la pratique n’est toutefois autorisée que pour des mères dites « transfrontalières » c’est-à-dire non népalaises et généralement indiennes…Sur le continent asiatique, la tendance est donc aujourd’hui à un durcissement de la réglementation. En Afrique, le Kenya a adopté une législation souple et développe un discours très commercial, il est possible aux parents d’intention de choisir le sexe, le nombre d’embryon, etc.
Au bilan, un tourisme procréatif existe et monopolise les moyens médicaux des pays les plus pauvres.
La GPA
au crible des principes féministes
En France, toute convention ayant pour objet un projet de gestation pour autrui est juridiquement nulle au regard du principe de non-patrimonialisation du corps humain. Dit autrement, ce dernier ne peut être considéré comme une marchandise.
Face à cela, une pression
organisée pour l’acceptation sociale d’une GPA dit « altruiste »
émerge. Au regard des intervenantes toutefois, rien ne peut venir légitimer
cette pratique qui contrevient au droit fondamental de respect du corps humain et
oriente le point de vue sur les seuls parents d’intention en négligeant la mère
porteuse elle-même.
Il existe par ailleurs une dissymétrie sociale et culturelle très forte entre les demandeurs et les mères porteuses, une rupture d’égalité qui dispose ces dernières dans une situation de faiblesse économique et altère le caractère librement consenti de l’engagement. Cette négation ou perte de liberté va plus loin et dans le cadre contractuel imposé, les femmes renoncent à d’autres libertés concrètes, le choix de leur alimentation, d’avoir des relations sexuelles, de fumer ou de subir une intervention chirurgicale invasive. Il existe peu de limitations au contenu de ces contrats.
Des enquêtes sur les motivations des femmes à consentir à devenir mère porteuse ont révélé que le premier motif était d’ordre financier et plus précisément de financer l’éducation des enfants, l’acquisition d’un logement ou l’ouverture d’un commerce pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles.
Le bénéfice n’est donc jamais attendu pour les femmes elles-mêmes mais, elles se « sacrifient » pour d’autres, pour leur famille alors même qu’il leur est souvent imposer de s’en éloigner et de se cacher le temps de la grossesse.
Une violence
médicale
La gestation pour autrui fait subir à la mère porteuse des traitements
(hormonaux) et gestes invasifs (implantation d’un embryon étranger)
significatifs et non sans risque pour sa santé. Parce qu’il est étranger
à la mère porteuse, le corps va réagir à cet embryon comme on réagit dans un
cas de transplantation, c’est-à-dire par desmanifestations de rejet comme
une élévation de la tension[1].
Puisque l’on sait que le « taux d’échec » est important, le recours à plusieurs mères porteuses dont une seule sera rémunérée est parfois proposé dans certains pays.
Les questions
que posent la GPA
Si dans les 70s, le mouvement féministe a tenté de lever la contrainte liée à l’obligation de s’assurer une descendance par la reproduction, la question de la GPA est révélatrice d’une nouvelle poussée de cette dernière. « Stérile ou non, voulant des enfants ou non, vous aurez des enfants », ce discours marque un retour de la pression familiale et sociétale à la reproduction. Par ailleurs, la voie de l’adoption comme solution pour les couples en désir d’enfant est aujourd’hui « démodée » et rétrogradée par la gestation pour autrui au nom de la possibilité d’établir un lien, une filiation génétique.
La suprématie du droit individuel sur le droit collectif, la mise en avant du consentement pour masquer les dominations en présence et le recours abusif à la notion de progrès sont autant d’arguments au secours de l’acceptation de la gestation pour autrui. La méconnaissance de la réalité du processus médical – opération pour le prélèvement d’ovocyte, fécondation in vitro et implantation, gestation à risque élevé et accouchement – participe par ailleurs d’une relative tolérance ou indifférence face au sujet.
La GPA est enfin un révélateur du rapport de force entre le Nord et le Sud, entre ceux qui peuvent acheter et celles qui se vendent. L’enfant n’est plus que le produit vendu sur un marché déséquilibré, biaisé à son entrée où les co-contractants ne négocient pas à armes égales.
Au bilan, on ne commercialise pas
seulement un enfant mais aussi une
filiation, il y a derrière cette transaction un double produit et un
double mensonge.
[1]
Environ 20-25% des
femmes d’après une étude faite au Pays Bas sur des GPA réglementées.

jeudi 7 novembre 2019 | Conférence
7 novembre 2019
Cycle Institutions et aliénations (3/4)
Cécile Marcel, directrice de l’Observatoire international des prisons (OIP)
Etat des lieux
Aujourd’hui en France, 71 000 personnes sont incarcérées dont 30% en attente de jugement avec une durée moyenne de détention inférieure à 9 mois. Les principales difficultés sont les question de l’emploi et de l’insertion, les addictions et les problématiques liées au manque relationnel. 2/3 des personnes se trouvent dans des maisons d’arrêt où le taux d’occupation moyen est de 140%. C’est là que les régimes de détention sont les plus stricts.
Focus sur le profil sociographique des détenus (peu de chiffres récents sont à disposition, les enquêtes sont toutes assez anciennes) :
- parmi les personnes détenues, 43% sont sans diplôme et 20% ont des problèmes de lecture
- 20% seulement avaient un métier stable avant leur incarcération
- 38% ont des problèmes d’addiction à des substances illicites
- 30% ont des problèmes d’alcool
- concernant les problèmes psychiques, 1/8 ont des problèmes mentaux et 25% ont été diagnostiquées psychotiques
La prison de trouve souvent en bout de chaîne quand les autres institutions ont échoué. Et là où elles ont échoué, on demande à la prison de réussir. Le tout dans un cadre contraignant et difficile.
Prise en charge proposée aux personnes détenues
Concernant l’éducation et la formation, il y a aujourd’hui 1 enseignant pour 100 détenus, moins de 25% des détenus ont accès à l’éducation et moins d’1 personne sur 6 a accès à la formation professionnelle. Pour les mineurs, le temps moyen d’enseignement par semaine est de 6h
Pour les activités rémunérées; 30% des détenus y ont accès et pour la plupart ce sont des auxiliaires qui vont travailler au service général de la prison. On leur propose surtout des activités peu qualifiantes, peu revalorisantes avec une rémunération très faible, dans un cadre légal peu protecteur. Ils sont rémunérés à la tâche ce qui entraîne un rapport au travail peu positif. Pour autant le travail reste une activité recherchée par les détenus car il faut continuer à payer des frais, exemple louer un frigo et autres services ce qui représente environ 200€/ mois au total
Soins
On manque de soignants en prison et à l’extérieur et en particulier de spécialistes. Souvent les postes sont prévus mais pas pourvus car le cadre est contraignant, il implique une logistique qui fait qu’il est difficile d’avoir un RDV. Ainsi la prison a tendance à renforcer les pathologies ou à en déclencher de nouvelles pour ceux qui n’en avaient pas
Activités
Le parent pauvre de la prison : jusqu’en 2014, le temps par détenu et par jour était en moyenne de 1h30. En 2015 le budget alloué étaut faible (évolution légère après les attentats car on a réalisé que la prison était un lieu de radicalisation). Aujourd’hui nous sommes autour de 3h d’activité par jour et par détenu. Remarque : le conseil de l’Europe préconise 8h/jour
Des activités freinées par plusieurs contraintes :
- logistiques : des infrastructures immenses loin des centres urbains donc difficiles d’accès pour les intervenants
- des prisons beaucoup plus tournées vers la sécurité (SAS, difficultés de mouvement entre les bâtiments)
- la difficulté d’obtention des permissions de sortie (ex : pour des troupes de théâtre dans la prison, difficulté de pouvoir jouer le spectacle à l’extérieur) Exemple de Radio Baumettes : une équipe forme des détenus à l’organisation d’une émission radio et eux-mêmes l’animent par la suite. Pour la 1ère fois, organisation d’une émission en public, mais plus de 50% des détenues n’ont pas obtenu les permissions de sortie le jour J.
Au final, le temps de détention est souvent qualifié comme un impensé, un « temps mort » dans la vie des détenus.
Préparation à la sortie
Les règles internationales préconisent d’avoir du temps aménagé en dehors de la prison pour favoriser la réinsertion. Mais aujourd’hui 80% des sorties sont des sorties sèches (98% pour les courtes peines de moins de 6 mois) donc très peu préparées. Une des raisons qui explique cela : les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont très largement surchargées avec une moyenne de 80 détenus par personne accompagnante. Ils se concentrent donc sur certains, notamment ceux qui font la démarche d’aller les rencontrer. Si pas de démarche des détenus, il est possible de passer tout son temps de détention sans être accompagné par quelqu’un. Et les postes de Pôle emploi ne sont pas suffisamment nombreux pour permettre un contact avec les détenus.
Au final de nombreuses difficultés s’annoncent à la sortie pour les détenus :
– Réadaptation à son espace, son environnement
– Démarches administratives (réinscription dans espaces de droit commun, RMI, CAF). Pour faire ces démarches, il faut une adresse et des papiers donc pour de nombreuses démarches l’accompagnement est insuffisant
– Difficulté aggravée pour trouver un emploi : casier judiciaire, absence de CV… (il est possible de se faire effacer son casier mais cela est compliqué et pas forcément accessible à tous)
Démarches de type CHRS mais problèmes de places et donc priorité aux personnes les plus sécurisantes – stigmatisation du sortant de prison.
Quid de la récidive ?
60% des ressortissants sont condamnés dans les 5 ans mais il y a une forte diminution forte quand le détenu est prise en charge après sa détention. Pour autant aujourd’hui une grosse partie des budgets sont alloués à l’extension des prisons, il a donc toujours plus de place en prison qu’en réinsertion
Angelina Chapin Directrice du service du CEAS (Bobigny)
La prison peut rendre criminel pour deux raisons ? 1. Si elle est totale 2. Si c’est l’unique solution.
Quelques chiffres sur la détention des mineurs :
- Aujourd’hui 783 mineurs sont en détention dont 600 mineurs en détention provisoire (parmi lesquels des mineurs qui ne sont pas encore jugés et 182 qui sont condamnés)
- 3 500 mineurs passent en détention chaque année
- 2 500 mineurs se trouvent dans des lieux de privation de liberté autres que la détention
- La durée d’une détention moyenne est entre 8 jours et 3 mois
Il existe différents établissements pour les mineurs :
- Les EPM – Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs : ils comptent 60 places, proposent plus d’activités que dans les maisons d’arrêt classiques : enseignement, médiathèque, centre de santé, activités sportives, cellules individuelles, coins de vie collective
- Les quartiers mineurs dans les maisons d’arrêt classiques : 49 places
- Les CEF – Centres Educatifs Fermés : 70 places à venir (certains en création)
Retour sur l’histoire de la détention pour les mineurs
En 1912 création de laJustice des mineurs avec des tribunaux spécialisés pour les mineurs et des délégués bénévoles. En 1945, une ordonnance légalise la prise en charge des mineurs délinquants qui étaient à cette époque des mineurs « à protéger ». « Nous ne sommes pas assez riches d’enfants pour ne pas nous en occuper ». L’objectif était de permettre une éducation face à un acte de délinquance qui était symbole d’un symptôme et non pas symbole d’un individu délinquant. Volonté de s’occuper davantage des mineurs délinquants pour les protéger et leur prodiguer une éducation Des professionnels spécialisés sont institués : tribunaux, magistrats, professionnels éducatifs, établissements et mesures spécifiques (un mineur lorsqu’il commet un acte doit être pris en charge jusqu’à son jugement – capacité à dire son évolution, gradation de ces mesures éducatives). Des mesures coercitives sont mises en place mais la détention doit être la dernière des solutions pour un passage à l’acte délinquant.
La prison peut rendre délinquant si elle est totale
Détention dans un même lieu, modalités de vie réglées où tout est pris en charge et les échanges limités ET si elle n’est pas pensée comme cette justice des mineurs qui vise à faire du jeune un être libre : une institution contenante et cadrante qui doit répondre à la mission de « protéger et éduquer » (une procédure pénale et un cadre mais dans une perspective bienveillante). La finalité doit être la recherche de justice qui permet pour l’adolescent d’aller vers une liberté. Ces jeunes entrent dans un acte de délinquance car qu’ils pensent que c’est la chose bonne et elle devient chose nécessaire une fois qu’ils sont entrés dans la délinquance. Il faut qu’ils puissent comprendre que cette chose entrave leur liberté, montrer ce qu’est la vraie liberté.
« la liberté ne peut se trouver dans les limites, on est pas libre et heureux si on a aucune limite »Cette gradation des sanctions devrait permettre d’accéder à la liberté.
La détention ne doit être qu’un passage, leur place n’est pas en détention.
Par son cadre la prison ne peut pas permettre à un enfant de tester les limites de la liberté, elle ne permet pas de permettre, elle ne permet pas de prendre des risques et de retravailler ces risques. C’est pourquoi il y a pour les mineurs un plus grand panels de réponses : centres éducatifs fermés etc. « Quand on rend service à des êtres ainsi déracinés et qu’on reçoit en échange de l’ingratitude (…) on subit simplement une part de leur malheur » Simone Weil
Yvon Rontard, directeur de services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), directeur de deux foyers
Dans son expérience, les jeunes vivent en meute et ils ont besoin d’avoir des êtres « très nus » face à eux, sans apparats. Cela été décapant, une grande purification de son personnage, ils l’ont fait accoucher de lui-même pour mieux entrer en relation
Jean-Baptiste de Lassalle parlait de « sauvageons » si on ne sort pas les enfants des rues et qu’on ne les éduque pas. En Seine Saint Denis l’âge moyen de déscolarisation est très bas. Il s’agit pour lui de « mettre des mots sur les maux » – dans les faits, aujourd’hui pas d’appropriation de ces mots parce qu’habitude de l’institution.
L’enjeu est de les confronter aux limites qu’ils se fixent eux-mêmes. Le but c’est de retrouver leur âme d’enfant. Ainsi dans l’un des foyers dont il s’occupe, les jeunes sont mis en relation avec des animaux.
Parfois, le coup d’arrêt de la prison peut être le début d’une genèse, d’une anamnèse. Nous ne sommes pas déterminés par ce qu’on a vécu, et il faut choisir un chemin de libération Ils ne peuvent pas faire confiance à la société parce qu’ils ont été trop trahis par le monde adulte mais l’enjeu c’est qu’ils puissent se faire confiance à eux-mêmes. Pour certains, ils ne peuvent pas croire à l’amour qu’on leur porte. Il y a un enjeu à partir du désir des jeunes et pas de nos projections sur eux
On croit toujours savoir ce qui est bon pour l’autre mais il faut une chasteté dans la relation – ne pas mettre la main sur l’autre.

lundi 28 octobre 2019 | Conférence
Conférence de Guillaume Dezaunay, professeur de philosophie en lycée à Metz.
Cycle Institutions et aliénation (2/4)
28 octobre 2019
Introduction
L’éducation, la couche subconsciente de la vie publique selon Emmanuel Todd
Pourquoi poser la question de l’éducation en ces termes un peu provocateurs ? C’est une question sérieuse car l’éducation est le moteur de l’histoire, selon les mots d’Emmanuel Todd. Selon lui, comme en psychologie, il y a le conscient de la vie publique : au premier abord, ce qui est considéré comme important pour une société c’est l’économie et la politique. Mais Todd dit qu’ il y a aussi une couche subconsciente et une couche inconsciente à cette vie publique. La couche subconsciente, c’est en gros l’éducation : c’est de la dynamique de l’éducation que dépend principalement la vie économique et politique. Une société qui s’alphabétise sera dynamique économiquement et politiquement. Si tout le monde apprend à lire, la démocratie devient une sorte d’évidence, et tout le monde sait lire un manuel donc on devient aussi très efficace. Bref, les questions éducatives sont plus que centrales : ce n’est pas inconscient, puisqu’on le sait, mais ce n’est pas pleinement conscient, puisqu’on débat plus sur des questions finalement plus superficielles à savoir des élections par exemple. L’inconscient, ce serait les structures familiales et les valeurs qu’elles entraînent mécaniquement.
Education massive = baisse du niveau ? Non, selon les journalistes, oui selon les profs
Une inquiétude émerge
régulièrement : Est-on en train de devenir collectivement plus bêtes qu’avant ? Le débat oscille
perpétuellement entre l’idée que le niveau baisse, et celle que nous
n’avons jamais été autant scolarisés, donc que nous sommes forcément plus
malins. C’est justement ce lien qui est attaqué par la question : la scolarisation massive va-t-elle de pair
avec une vie de l’esprit plus riche ?
Deux type de personnes répondent communément à cette
question :
- les journalistes d’émissions appartenant, pour
reprendre une expression de l’extrême droite et de la droite conservatrice, au
« camp du bien », c’est-à-dire aux médias qui définissent une manière
morale de penser. Guillaume Meurice interroge régulièrement des vieux réacs qui
sont dans le « c’était mieux avant, maintenant ils sont tous cons et
méchants », et il leur pose une question du genre : qu’est-ce qu’un
logarithme népérien ? ». Quand ils ne savent pas répondre, et il leur
fait remarquer que c’est au programme de terminale S et qu’ils ne sont donc pas plus cultivés que
les jeunes. Dans ces médias, dire que le
niveau baisse est une sorte d’interdit moral, et marqueur d’appartenance à
la caste interdite des réactionnaires.
- Les profs qui
considèrent avec une certaine unanimité que la vie scolaire est dans l’ensemble
plus difficile qu’avant, que le niveau de français est de moins en moins bon,
que le désir de connaissance et la volonté ne sont pas en train d’augmenter,
bref que la situation n’est pas glorieuse. L’augmentation
des nombres de suicides et surtout de dépression parmi les enseignant sont
le signe objectif d’un mal être global chez les enseignants.
Donc pourquoi cette question ? Parce qu’il faut réfléchir à l’éducation et à l’école, et parce qu’on sent bien que l’institution ne remplit pas assez bien ses missions. La question centrale sera bien sûr : pourquoi ?
Qu’est-ce qu’être bête ?
Avant de proposer des réponses, il faut définir le mot
bêtise. Dans la bêtise, il y a l’idée d’animalité, être une bête, d’être
incapable de transformation. La néoténie
est un des critères de différenciation entre l’homme et les autres animaux.
Ce terme désigne la nature incomplète de l’homme : il doit se compléter culturellement, et
l’humanité est cette capacité à être cultivé, à transformer ses besoins et ses
pulsions naturelles en autre chose de plus raffin. Par exemple : cuisiner
plutôt que manger, faire des arts martiaux et du hip hop plutôt que se battre,
faire des maths pour elles-mêmes plutôt que compter le nombre d’adversaires,
aimer plutôt que se reproduire, etc.
La bêtise ne s’oppose
donc non pas à la simple intelligence mais à l’humanité cultivée. Un homme
bête est un homme qui ne se transforme pas. Jacques Brel dit un peu cela quand
il donne une définition d’un homme bête : “un type qui vit et il se
dit : ça me suffit. Ça me suffit.”
Mais ça peut être aussi quelqu’un qui est blasé, c’est-à-dire qui ne s’étonne plus, de rien, qui en sait assez. Ce peut être aussi quelqu’un qui connaît beaucoup de choses, mais qui n’est pas transformé par ce qu’il connaît. On peut alors être à la fois cultivé et bête, si la culture que l’on a n’est pas du tout un facteur de transformation de soi et d’enrichissement de la vie de l’esprit, mais un simple moyen de se satisfaire de ce qu’on est ou de ne plus se poser de questions ou de se donner une apparence. Les philistins décrit par Hannah Arendt, ou les bourgeois décrit par Léon Bloy sont bêtes dans ce sens : ils savent pas mal de choses, mais ils n’en tirent pas de transformation de leur esprit. Avec cette définition, nous sommes tous dans une certaine mesure bête : sortir totalement de la bêtise est parfaitement impossible, le mieux à faire est de déployer une vie de l’esprit plus ou moins riche mais qui n’empêchera pas de retomber régulièrement dans la bêtise de toute façon.
L’école nous rend-elle bête ?
A la question L’école
nous rend-elle bête ?,
il serait vraiment violent et injuste de répondre oui. Et à mon avis
vraiment injuste. On pourrait plutôt répondre que l’école ne rend pas bête mais échoue à nous faire sortir de la bêtise. Et
si elle échoue, c’est pour quatre raisons dont une seule dépend vraiment
d’elle.Dire cela c’est dire que l’école est ENCASTREE dans la société et qu’on on ne peut rien comprendre de
l’école si on l’étudie de manière analytique séparée du reste.
Les 4 causes d’échec identifiées :
1) La première est une cause endogène, liée à l’organisation
et à la structure de l’école : L’école est une grosse bureaucratie
dont le gigantisme a des effets contreproductifs. Globalement, c’est
une thèse défendue par les anarchistes, et en particulier un anarchiste
chrétien flamboyant qui inspire ce cycle de conférence, à savoir Ivan Illich.
Il y a du vrai dans ses thèses, même si l’idée qu’une société descolarisée
serait paradoxalement plus riche spirituellement peut paraître quasiment folle.
2) la deuxième est une cause exogène, liée à la vie
numérique : La compétition pour le temps de cerveau disponible
fait rage et l’école perd cette compétition au profit de ses ennemis, les
industries de programme que sont la télé et les réseaux asociaux.
3) une troisième cause, également exogène, est liée à la
culture individualiste : La culture contemporaine a des
caractères d’anti-culture en ce sens qu’elle préfère l’innovation et la
table-rase perpétuelle à la transmission du passé. Difficile de justifier une
éducation traditionnelle comme le propose l’école dans ces conditions.
4) Et la dernière cause, exogène, est liée aux problèmes économiques contemporains : Le récit collectif de la méritocratie devient de moins en moins convaincant puisque l’inégalité se pérennise comme reproduction, ce qui ne donne pas très envie de s’investir à fond dans l’école, cœur du dispositif méritocratique.
L’école bureaucratique
- Selon Illich, toute institution exclusive est aliénante pour les individus
Pour appuyer ce premier axe de réponse, Ivan Illich a
un premier argument : dès lors qu’une
institution devient gigantesque et exclusive, elle est aliénante pour les
individus. Prenons l’exemple de l’hôpital. Il devient exclusif :
on ne peut plus naître chez soi, mourir chez soi, se soigner chez soi : on
devient irresponsable en matière de santé, complètement dépendant des médecins.
Selon lui, il faudrait plutôt des petits dispensaires un peu partout où l’on
apprenne à se soigner soi-même et réserver l’hôpital pour les cas les plus
techniques.
C’est la même chose pour l’école : quand elle devient
obligatoire, elle devient par le même coup exclusive. De même que seuls les
médecins ont les compétences pour soigner, seuls les profs ont les compétences
pour enseigner. C’est une forme d’aliénation : on en oublie la possibilité
d’apprendre à l’extérieur des choses qui n’ont pas la forme d’un programme
scolaire, qui ne s’évaluent pas par notes, et qui sont surprenantes.
En ce sens l’école rend bête : elle forme des élèves
moins curieux, moins attentifs aux événements de la vie, moins capables
d’apprendre de tout. Elle déresponsabilise dans l’accès à la connaissance.
Par ailleurs , elle habitue à se faire noter en
permanence par des bureaucrates au point qu’on va peu à peu mélanger le savoir
et le diplôme, l’intelligence et la note, au risque de faire perdre la
confiance en soi de tous ceux qui galèrent un peu dans le système scolaire.
Dans La convivialité
Ivan Illich dit :
« L’enseignement fait de l’aliénation la préparation à
la vie, séparant ainsi l’éducation de la réalité et le travail de la
créativité. Il prépare à l’institutionnalisation aliénatrice de la vie en
enseignant le besoin d’être enseigné. Une fois cette leçon apprise, l’homme ne
trouve plus le courage de grandir dans l’indépendance, il ne trouve plus
d’enrichissement dans ses rapports avec autrui, il se ferme aux surprises
qu’offre l’existence lorsqu’elle n’est pas prédéterminée par la définition
institutionnelle. »
Ce côté anti-institution peut agacer chez Illich. Mais cette déconstruction et l’absence d’institution pourrait donner lieu à l’auto-institutionnalisation de soi, et non à une désorientation également angoissante. En fait Illich, comme Bourdieu, a influencé l’école : on en a conclu qu’il faut ne pas apprendre mais apprendre à apprendre. Et comme apprendre est aussi un bon moyen d’apprendre à apprendre…
2. L’école est trop contraignante pour que les élèves apprennent de leur curiosité
Deuxième idée, c’est que l’école obligatoire pose un
problème sérieux : celui de la contrainte. Or, il est certain que la
croissance dans le savoir est beaucoup plus puissante si son moteur est le
questionnement personnel. On apprend des choses passionnantes à des gens qui ne
se sont pas posé de questions sur ces sujets. Beaucoup d’élèves se sentent
enfermés comme des enfants en cage.En résultent beaucoup d’apprentissage non
compris, appris vaguement plus pour faire plaisir ou par peur qu’autre chose…
Pour Kant déjà, des vérités de fait, par exemple une chronologie, peuvent être apprises par contrainte,mais dès qu’on veut entrer dans la réflexion, par exemple les causalités entre les faits, la contrainte ne fait plus sens et détruit le sens même de la réflexion. Pour Socrate, on n’apprend pas de qui l’on n’aime pas. on peut considérer qu’il est difficile d’aimer celui qu’on n’a pas le choix d’écouter…
L’école en compétition avec les industries de programme
- Une compétition économique pour le temps de cerveau disponible
En demandant
aux élèves dans leurs fiches de présentation en début d’année combien
d’heures ils passent devant les écrans par jour, la réponse est de 4h en
moyenne, et peut monter vers 8h, voire même 12h durant le weekend. Ces écrans,
ce sont la télé (qui est loin d’avoir disparu avec l’arrivée d’internet, de la
même manière que le pétrole n’a pas remplacé le charbon mais s’y est ajouté),
et bien sûr internet, en particulier les applications de réseaux sociaux.
Bernard
Stiegler écrit sur le site de son association Ars Industrialis :
« Les institutions
de programmes que sont la famille et l’école ont désormais pour concurrentes les industries de programmes que sont les industries culturelles. Si on
peut qualifier l’école d’institution de programme c’est qu’elle a en effet pour
fonction de faire adopter des « programmes », des conduites, des
savoir-faire et des savoir-vivre. Ceci demande bien sûr de former l’attention
des élèves. L’école « de Jules Ferry » fut, de ce point de vue, un
dispositif, fondé sur le livre, de formation de l’attention (rationnelle), et
au-delà de la « majorité ». Les industries de programmes, en
tant que bras armés de la télécratie, ont pour but de prendre le contrôle des
programmes comportementaux qui régulent la vie des groupes sociaux, et donc
d’en dessaisir le système éducatif, pour les adapter aux besoins immédiats du
marché. Il faut ne pas connaître d’enfant ou d’adolescent pour ne pas savoir
que la télécratie est le principal ennemi de l’école. »
L’idée est globalement la suivante : l’économie numérique est un gigantesque vivier de profit, mais il faut que des spectateurs et internautes passent du temps devant leurs écrans pour en tirer des revenus. Les entreprises télévisuelles et numériques entrent alors dans la compétition pour le temps de cerveau.
2. La télé et internet soutiennent l’assouvissement de pulsions et en empêchent la sublimation culturelle
Pour
schématiser, l’ancienne télé était une sorte d’allié de la famille, de l’école
et de l’Etat. Elle était nationale, instructive, un peu ennuyeuse. C’est
surtout la privatisation des chaînes qui va ouvrir une nouvelle dynamique :
avec elle va commencer la compétition pour l’audience, qui va voir peu à peu
les transgressions de la morale vaincre.
Cela va
commencer par l’impudicité : la
vie amoureuse et sexuelle trouvent leur place dans des émissions de témoignage.
Ce n’est pas inintéressant, des spectateurs se disent qu’enfin on parle de la
vraie vie! Mais dans un deuxième temps, de simples témoignages ne suffisent
plus : des révélations en direct, de
tromperie, d’humiliations, de honte commencent à briser les tabous en live. Les
ados sont vite une cible de cela (particulièrement dans un autre média, la
radio, où les émissions visant à raconter le sexe et à se faire littéralement
humilier sont nombreuses, par exemple sur skyrock).
Assez vite
naissent des émissions brisant d’autres tabous, notamment le respect de la cohésion sociale. Le modèle serait Le maillon faible, où le rejet du plus faible est encouragé sur
des arguments purement subjectifs (“ il est lent, sa tête ne me revient pas…”).
Ensuite ce concept de compétition où les plus faibles sont éliminés s’étend à
presque toutes les émissions grand public.
Un nouveau
tabou est brisé avec l’encouragement de
l’agressivité par la culture du clash et de la violence verbale. Le summum
est atteint par la téléréalité avec la fameuse émission de M6, Loft Story, pour laquelle des personnes
sont enfermées en espérant qu’il en ressortira principalement de l’agressivité
et du sexe. Cette émission servira de modèle à de très nombreuses émissions
ensuite, de la Star Ac’ qui a tout de
même une dimension culturelle, à L’île de
la Tentation dans laquelle l’objectif est simplement de s’amuser à briser
des couples.
Dans ses
analyses, Bernard Stiegler remarque que ces
émissions flattent les pulsions.
Ce fond
inconscient d’eros et de thanatos est en absolument tout le monde, mais leur expression directe n’est généralement
absolument pas encouragée par les sociétés, qui en cherchent au contraire la sublimation c’est-à-dire la
transformation sous des formes culturelles. En effet, l’expression directe des
pulsions relève de la bêtise et conduit collectivement à la guerre civile, d’où
l’enjeu central de leur sublimation. Mais quand ces pulsions sont flattées , il
est très difficile d’y résister puisque ces pulsions sont en nous : il est
impossible ou presque de ne pas être excité quand il y a un clash, il est très
difficile de ne pas être attiré lorsqu’il y a du sexe, il est difficile de ne
pas être emporté par un phénomène de bouc émissaire. En conséquence, énormément
de personnes ont l’attention captée par ces émissions anti-culturelles,
c’est-à-dire anti-sublimation.
Une amélioration pouvait être espérée avec la technologie participative d’Internet, en opposition à la passivité à laquelle conduit la télé. Mais l’exploitation de la pulsion sur internet prend des formes extrêmes avec le développement d’applications très addictives et une omniprésence du porno. Le porno est un accès à la sexualité pulsionnel et l’exploitation de la pulsion mène à la destruction du désir, c’est-à-dire de la sublimation : pas d’histoire, pas d’amour, pas de transformation.
3. L’addiction à la distraction est alimentée par le financement des médias et détruit la capacité d’attention nécessaire pour l’éducation à l’école.
Les
programmeurs des réseaux sociaux ont
pour objectif d’y faire rester les consommateurs et de les rendre addicts. Ils
cherchent pour cela à déclencher la production de dopamine c’est-à-dire du
plaisir à base de like. Le mélange aléatoire de contenu intéressant avec du
contenu divertissant alimente aussi le scrolling.
En demandant
à mes élèves comment ils envisagent une journée sans écran, leurs réactions
sont “vous voulez ma mort monsieur ?” Et , nouvelle réaction de cette
année, “comment on fait pour les flammes sur snap ?”. C’est évident, Snap
vous veut du mal, le but des flammes est la dépendance.
La publicité
vient se rajouter à cette grande industrie de la distraction. Il faut lui
préparer sans cesse les esprits, comme Patrick Le Lay, PDG de TF1 en 2004, le
dévoilait dans son livre Les
dirigeants face au changement :
« Il y a beaucoup
de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réaliste : à la
base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu’un message
publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit
disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible :
c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages.
Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est
du temps de cerveau humain disponible. Rien n’est plus difficile que
d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le changement permanent.
Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes,
surfer sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se
multiplie et se banalise. La télévision, c’est une activité sans mémoire. Si
l’on compare cette industrie à celle de l’automobile, par exemple, pour un constructeur d’autos, le
processus de création est bien plus lent ; et si son véhicule est un
succès il aura au moins le loisir de le savourer. Nous, nous n’en aurons même
pas le temps ! Tout se joue chaque jour, sur les chiffres d’audience. Nous sommes le seul produit au monde où l’on ‘connaît’ ses
clients à la seconde, après un délai de 24 heures. »
Dans cet
extrait, hormis son cynisme radical, la notion de temps de cerveau disponible est fascinante. Les applications pour
smartphone lui donnent toute son ampleur, plus encore que la télé. Le scrolling
sans but donne une assez bonne image de l’enfer : mélange d’enfermement et de douleur
auto-infligée. Tout scrolleur de talent devient vite très fatigué, puisqu’il ne
parvient pas à se coucher le soir, sans cesse en retard même quand il n’a rien
à faire, et à moitié dépressif, puisque son addiction stérile l’amène peu à peu
à se mépriser lui-même. Le tout en envoyant en masse des données à Google et
compagnie pour qu’ils construisent un joli « profil utilisateur »
qu’ils vendront à tout un tas de gens spécialisés dans le but de nous suggérer
des désirs inutiles et chronophages. La question devient donc :
« Mais pourquoi diable s’inflige-t-on à soi-même de tels coups ?
Quelle est la source de ce masochisme ultime, pratiqué allégrement par une
génération entière ?”
Le scrolling est
l’union intime du divertissement et de l’ennui. En gros : on fuit
l’ennui dans un divertissement qui nous ennuie. On fuit la solitude dans une
activité qui nous isole. Il n’y a plus de porte de sortie. C’est le malheur.
En bref, l’école lutte contre des ennemis trop
puissants. L’attention des élèves est largement captée par des industries
de divertissement qui les touche directement au niveau des pulsions et des
besoins les plus essentiels comme la quête de reconnaissance (qui pour les ados
est le cœur du cœur de la vie), alors que
l’école apporte des programmes qui exigent du temps long,
l’approfondissement de problèmes lointains, la reconnaissance de son ignorance,
le développement d’un langage élaboré… Impossible de lutter.
Comme le dit Stiegler, « Il faut ne pas connaître d’enfant ou d’adolescent pour ne pas savoir que la télécratie est le principal ennemi de l’école. » Que faire quand on entend que Hanouna veut se présenter en politique ? Porter plainte contre Hanouna, Le Lay, Cauet, et tous ces hommes de médias qui détruisent littéralement les capacités d’attention de notre jeunesse et ne leur donne pas les moyens de sublimer leurs pulsions et leurs désirs ?
L’école à l’ère de la préférence pour la nouveauté
- Une modernité basée sur le rejet de la transmission
La culture contemporaine a des caractères d’anti-culture en
ce qu’elle préfère l’innovation et la table-rase perpétuelle à la transmission
du passé. Un penseur précieux pour penser ce phénomène est Peter Sloterdijk et son livre Après
nous le déluge.
Peter Sloterdijk tente, en philosophe de l’histoire, de
faire un diagnostic général des temps modernes, présentés comme “règne de la
nouveauté permanente” et comme “fuite en avant un peu folle”. Ce « nouvel esprit du temps » est
le tournant futuriste, qui pose la primauté de l’avenir contre la primauté du
passé. Il est joyeux, nonchalant, même s’il contient vaguement l’intuition
tragique des désastres à venir. La
spécificité de la modernité résiderait dans sa réinterprétation du rapport
entre le passé et le futur : alors que la culture consiste
généralement à transmettre les savoirs, les croyances et les manières d’être
hérités du passé aux nouveau-venus, en les intégrant ainsi dans un
déjà-existant dont les valeurs sont perçues comme véritables, les modernes
donnent la prééminence au futur. Pour les modernes, « les événements les
plus importants, dans le mal comme dans le bien [sont peut-être] ceux qui
ne se sont pas encore produits ». La réalité devient la « possibilité de
ce qui suit ».
Quelques extraits d’Après
nous le déluge de Sloterdjik nous précisent sa pensée :
« Là où avaient régné les filiations – transmissions
fidèles de l’héritage paternel aux descendants et aux descendants de
descendants, aussi fictifs fussent-ils –, les interruptions de la tradition
creusèrent de profonds fossés. »
“La modernité est l’entrée dans un « théâtre
d’improvisation », où le passé comme guide sûr n’existe plus. La passé y
subit toutes sortes d’attaques. Les Jacobins en particulier invitent à décrier
la réaction en tant que « résistance dépassée de l’ancien contre le bon,
lequel allait activement de l’avant. […] Ce qui existe et persiste sera dans
l’iniquité ; ce qui va de l’avant et bat le tambour en faveur des libertés
a tout le droit de son côté. […] Le monde des pères apparaît comme dépossédé de
ses droits.[…] Ce qui a été et qui est encore présent est précipité dans le
néant du manque de légitimité. »
C’est toute la
modernité que Sloterdijk englobe sous ce signe de la délégitimation de
l’existant et du déjà-là. Léon
Trotsky invitant à la « révolution permanente », les américains faisant l’éloge du «
self made man » sans racine se faisant tout seul dans l’improvisation, Mao Zedong imposant la
« mobilisation permanente », ou l’éloge omniprésent depuis les années
80 de l’innovation : c’est toute la modernité qui donne au futur la
préséance. Madame de Pompadour
elle-même en est une sorte d’incarnation, elle qui, de basse extraction, elle
« la fille de bourgeois, l’usurpatrice, la bâtarde, avait réussi
l’impossible », est parvenue à devenir la maîtresse officielle de Louis XV
et la régente cachée du royaume. Elle est l’image du futur self made man.
La déstabilisation, aussi bien politique que psychologique
est LE problème moderne. Le monde
moderne est en proie à la déstabilisation permanente, au tumulte des
révolutions, au déracinement, à la possibilité du déluge. Là où les
maladies psychiques du 19e siècle procédaient d’un excès de contrainte sociales
et relevaient surtout de la frustration, les maladies psychiques du 20ème sont
surtout l’angoisse, la déstabilisation, la désorientation qui relèvent de
l’absence de guide.
Au lycée, la quantité d’élèves présentant des angoisses est
en augmentation perpétuelle. Une Conseillère Principale d’éducation (CPE) du
lycée où enseigne le conférencier se demande si ne n’est pas justement
l’absence de frustration dans la jeunesse qui est à l’origine de ces
angoisses…
La déstabilisation des filiations propre au monde moderne se reflète dans l’accession de la notion de « liberté » au rang de principe directeur des cultures. Les formules de l’auteur pour désigner cette liberté moderne sont toutes ironiques. Il présente la liberté comme un terme visant à qualifier le sujet néo-instable dont le passé a été désactivé et qui doit « se choisir » ou « s’inventer » lui-même. La désorientation et la perte de repères font partie intégrante de cette liberté à laquelle nous serions plus condamnés qu’autre chose. « Les libres, ce ne sont pas seulement ceux qui se sont débarrassés d’un maître. Ce sont aussi ceux qu’on a abandonnés en rase campagne sans explication ».
2. Une difficulté à assumer une culture de la transmission dans l’enseignement
Il est difficile d’enseigner dans ce cadre. Des enseignants
ont même parfois honte et n’assument pas du tout leur légitimité à transmettre,
se demandant “Qui suis-je pour dire ce qui est bien ?”. Même dans
l’enseignement de la philosophie, matière qui encourage par essence l’esprit
critique on assiste parfois à une sorte d’excès d’esprit critique. Un peu de
piété envers les œuvres, ne serait-ce que le temps de les comprendre avant de
s’en distancer, serait plutôt bienvenu.
Pour illustrer ce discours basé sur la disqualification de
la transmission, prenons l’exemple d’un article récent, « La
présidente du CSP fait sa rentrée à l’extrême-droite » publié le 10
septembre 2018 par B. Girard dans son blog de médiapart. Notons que
le titre est déjà très révélateur, sous-entendant que qui ne critique pas la
transmission du passé vient de l’extrême droite.
“C’est à Causeur que Souad Ayada a choisi de confier sa philosophie sur la réforme du lycée et plus généralement sur l’état de l’école en France, son « rêve », dit-elle. Face aux questions décomplexées de Causeur, les réponses de la présidente du CSP (Conseil supérieur des programmes) sont tout autant décomplexées et le rêve tourne au cauchemar. Une parenthèse autobiographique – une réussite qui a permis « d’échapper aux déterminismes sociaux » – lui donne l’occasion de désigner l’adversaire : « les politiques cyniques et les élites intellectuelles gagnées à la déconstruction dans ce processus d’épuisement de notre modèle scolaire ». Car la chose est entendue : en écho au porte-parole du gouvernement qui assimile les enseignants à des « criminels », Souad Ayada désigne également les coupables, ses coupables : avec une hargne toute brighellienne, elle s’emporte contre « l’influence considérable des constructivistes, de ceux qui défendent l’idée que l’élève construit ses savoirs et que le maître n’est donc pas le tenant d’un savoir qu’il transmet ». Docteure en philosophie et inspectrice générale de l’EN, son éloignement manifeste des salles de classe et sa méconnaissance des réalités du terrain lui permettent d’aligner les poncifs comme des perles ; ainsi sur « l’inflation des métadiscours, par exemple ceux qui affirment la nécessité d’apprendre à apprendre, de comprendre et de critiquer avant d’apprendre quoi que ce soit. » Dit autrement, pour la présidente du CSP, apprendre sans comprendre est la finalité première de l’école.
L’école à l’ère de la panne de la méritocratie
La poursuite de la valeur ultime d’égalité donne sa valeur à
l’école publique française. Devant la loi, cette égalité est respectée. Mais
quand est-il de l’égalité réelle ? Ce
sont les lois sociales et l’école qui ont la charge d’instaurer l’égalité
réelle.
Mais qu’est-ce que l’égalité réelle ? Il s’agit déjà de diffuser
les même savoirs pour tous, mais également de l’idée que les plus hauts statuts
ne s’acquièrent pas grâce à la naissance et aux privilèges, mais grâce au
travail, au mérite, aux talents.
Marie-Claude Blais,
philosophe de l’éducation, relève une ambivalence
dans cette idée d’égalité : « le principe d’égalité, en posant
l’indépendance des personnes à l’égard de toute forme d’appartenance, les
enchaîne davantage à leurs propres aptitudes : les individus n’échapperont
aux déterminismes du groupe que pour être renvoyés à leur destin particulier et
à leur nature individuelle ». De plus, comme l’écrit John Dewey dans Democracy and
Education, « il appartient à l’éducation de découvrir les capacités de
chaque individu et de les porter à un point extrême de perfection ».
L’égalité des chances doit également fait éclore les talents particulier pour
les faire servir au bien commun. Derrière
l’idéal d’égalité il s’agit donc d’abord d’uniformiser l’accès au savoir et aux
responsabilités au-delà des origines sociales, puis exalter les différences
propres de l’individus. La tensions entre ces deux aspects est très forte
sur ce sujet, et déborde d’ailleurs largement la question de l’école.
En quelques mots, la société des privilèges hérités est remplacée par une société de méritocratie, ce qui pose quelques problèmes. Tout d’abord, on peut constater que l’école méritocratique ne marche pas : comme l’a montré Bourdieu, l’école favorise les bourgeois et la reproduction globale et augmente l’écart et la honte de ce qui ne cadre pas. Deuxième limite à la méritocratie, les plus méritants sont aussi les plus conformistes et pas forcément les plus audacieux. Cela crée peu à peu une élite un peu décevante… Troisième limite, la violence de l’idée méritocratique : si quelqu’un n’y arrive pas, c’est intégralement de sa faute, c’est un loser. En réalité, d’autres facteurs contribuent à expliquer les différences dans les réussites scolaires que le simple effort personnel. Ensuite, il faut noter que certaines écoles fonctionnent de nouveau au “suffrage censitaire”. C’est le système des écoles américaines et en France des écoles de commerce, qui peuvent s’avérer être de véritable écoles de sophistiques néfastes pour le bien commun et pour l’intelligence. Enfin, notons la grande violence de la méritocratie en cas de récession économique, puisqu’alors le contexte économique fait que l’école ne permet plus de s’élever.
Conclusion
Pour conclure, ,empruntons à Kant quelques unes de ses
réflexions sur l’éducation. Il affirme que l’homme a besoin d’un maître, et
qu’il doit le trouver dans l’espèce humaine… c’est-à- dire parmi des gens qui
ont eux-aussi besoin d’un maître. Nous avons aujourd’hui de drôles de
maîtres : des maîtres qui disent qu’il ne faut surtout pas de maître, des
maîtres qui veulent juste vous vendre de quoi consommer et vous occuper
l’esprit, des maîtres qui voudraient bien l’être mais que personne n’écoute et
qui n’ont pas envie de contraindre. Kant affirmait déjà le besoin d’expériences
en éducation et de réforme perpétuelle. Aujourd’hui, la réforme nécessaire est
une réforme culturelle et se confronte aux stratégies industrielles ambitieuse
de l’économie du numérique… La meilleure chose à faire est-elle ainsi d’équiper
les adolescents de tablettes et d’ordinateurs ?